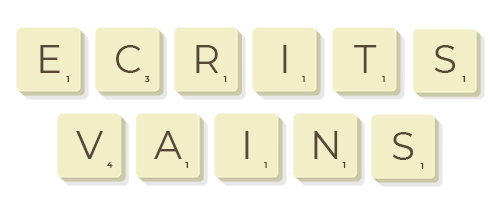Découvrez cet outil vous permettant de tricher au Scrabble via ce générateur de combinaison de Scrabble* (appelé également Solveur).
Comment tricher au scrabble ?
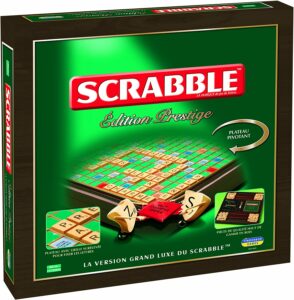
Le jeu du Scrabble
Utilisez simplement notre générateur de mot pour tricher au Scrabble en un clic et en ligne.
Entrez tout simplement vos lettres de l’alphabet Français et le générateur de mots va se baser sur l’ODS** 8 du Scrabble pour vous proposer les meilleures combinaisons de mots pour que vous puissiez remporter votre partie. Choisissez dans la liste de mots classés par nombre de point, celui qui vous convient le mieux pour battre votre adversaire. Vous pouvez recommencer l’opération autant de fois que vous le souhaitez. Pour votre joker, il suffit d’entrer le symbole ?. Ce solveur vous fera gagner toutes vos parties contre vos adversaires, même les plus redoutables.
Vous aimez jouer au Scrabble avec vos amis ou sur l’ordinateur contre des joueurs en ligne ? Utilisez en toute discrétion notre anagrammeur de Scrabble pour épater vos amis et vous aider dans vos parties de jeux. Le Scrabble est un jeu familial créé en 1948 par James Brunot.

Comment fonctionne notre logiciel pour tricher au Scrabble ?
Notre algorithme et solveur de Scrabble se déroule en trois étapes.
- Les mots sont piochés dans la base de données en fonction des lettres que vous avez renseignés.
- Une deuxième étape est nécessaire si des blancs/jokers ont été utilisés
- Notre outil pour tricher au Scrabble classe par ordre décroissant les meilleures combinaisons de mots
*Le Scrabble est une marque déposée
**Dictionnaire officiel du Scrabble